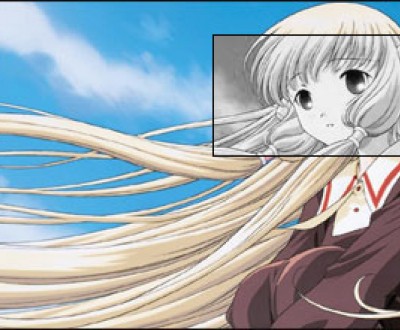Japonisme mangamaniaque : du canonique au catatonique
Analyse du phénomène manga au Japon
On nous le rabâche suffisamment comme ça : le marché du manga au Japon représente des centaines de milliards de Yens 💴. L’industrie qu’il constitue requiert donc un certain type de repères, destinés à baliser des voies, parfois très précisément, afin de toucher différentes variétés de publics. Globalement, le schéma de fonctionnement d’un manga suit des constantes clairement établies. Le mangaka (dessinateur et, souvent, scénariste) pré-publie chaque chapitre dans un mangazasshi, un magazine dédié, souvent hebdomadaire ou bimensuel. La distinction de l’audience se fait en amont, puisque ces revues sont sévèrement catégorisées selon les distinction connues : shônen pour les garçons adolescents, shôjo pour les filles adolescentes, seinen pour les jeunes adultes, yaoi et yuri pour les productions gays, etc.
Les mangashi proposent invariablement des cartes-réponse, sur lesquelles les lecteurs jugent leur appréciation des séries proposées à la lecture. Les séries populaires sont rééditées, tous les dix/quinze chapitres, sous formes de petits volumes appelés tankôbon. Ces reliures constituent le très gros du marché manga en occident, et notamment en France. Tant que le public adhère, la série doit continuer, ce qui donne des lourdeurs comme les courses de motos infernales d’Aa! Megamisama, ou des redondances décennales telles que les innombrables Gundam. En cas d’impopularité d’une série, l’éditeur du mangashi choisit généralement d’arrêter sa diffusion, et de libérer les pages pour une nouvelle production. C’est ce qui explique les épilogues un peu rapides, voire alambiqués, de certaines séries (par exemple, Togari de NATSUME Yoshinori). Dans ces conditions, que deviennent la prise de risque et l’originalité, là où la créativité est exclusivement motivée par l’intérêt suscité auprès des lecteurs ?
Le danger corolaire est que le manga perde de son aspect artistique dans le processus de création pour répondre à des demandes établies, et respecter alors à la lettre différents cahiers des charges très précis pour différents types de publics. Ainsi, la créativité dans le manga se résume à répondre à la demande par une offre inexorablement redondante. Qui n’a jamais eu l’impression de revoir dans deux productions différentes deux séquences très identiques ? Plusieurs artistes s’essayent régulièrement, avec plus ou moins de succès, à sortir du lot et offrent alors des productions originales. C’est le cas de Samurai Champloo qui mixe très habilement hip-hop et rônin, sur un style technique différentiel et racé. Las ! Devant le peu d’audience, la série a manqué de peu l’avortement à mi-chemin, avant de revenir plusieurs mois plus tard sur une chaîne câblée, en horaire de nuit.
Le cas de KATSURA n’est pas si éloigné des récentes mésaventures de WATANABE. Denei Shôjo Ai, alias Video Girl Ai, a rencontré un tel succès qu’elle a complètement englouti toute tentative de sortie du genre pour son auteur. Et si « K2R » aime Batman et la science-fiction, le public boude Shadow Lady, Zetman, et ses petites nouvelles velléitaires. Son éditeur râle ; le mangaka rempile alors avec le « sentimentalo-shônen » I’’s, copier/coller éhonté de l’œuvre précitée, qui durera près de cent cinquante chapitres. Et donnera d’ailleurs naissance à une horreur animée, pariant sur l’absence totale de scénario. L’exemple prouve à quel point un auteur peut être manipulé par son audience, jusqu’à une négation totale de l’originalité vers le recopiage scandaleux d’une œuvre déjà vendue.
Les animés n’échappent pas à une telle hécatombe artistique. Dans le petit monde de la japanimation, quelques studios emploient les mêmes animateurs, les mêmes techniques, et jusqu’aux mêmes doubleurs. Rouages et recettes sont identiques d’une série à l’autre, tendant vers l’équation toujours plus mercantile « tirage en longueur + réduction des frames intervalles + répétitions des séquences = carton en perspective ». Du coup, les animés d’aujourd’hui sont invariablement les mêmes que ceux d’hier : poitrines énormes, pilotes de méchas paranoïaques, saignements de nez, couleurs de cheveux à faire pâlir un prisme, répétition à outrance des mots-clés, rétablissement qui rend plus fort, etc. De même, il existe des types de personnages qui sclérosent le character-design : l’ado mâle obsédé mais au cœur pur, la fille canon hyperactive finalement amoureuse, le méchant qui vire gentil et meurt en protégeant un déjà gentil qui ne croyait pas en sa reconversion, etc. Ceux-là même qui remportent toutes les palmes à l’Anime Grand Prix.
Rendons-nous à l’évidence, ceux qui tiennent les rennes du manga prennent les clients pour des abrutis. Et ceux qui financent cette industrie, appelés « lecteurs » en euphémisme, réclament qu’on les prenne pour tels. Au Japon, le marché a connu plusieurs évolutions qui lui confèrent un statut différent de la bande dessinée en Europe ou du comic book aux États-Unis. Utilisé comme outil pédagogique, informatif ou institutionnel, il guide ses consommateurs sur la marche à suivre pour remplir sa feuille d’impôts et éviter les MST, ou encore enseigner un bout de l’histoire de France (Versailles no Bara). Dès lors, le manga de détente n’est qu’un genre parmi d’autres. Pour exister, il doit observer des règles nihilistes de l’originalité, l’emportant dans une spirale relayée par des moutons consommateurs.
Curieusement, sur ce point, l’occident semble plus clairvoyant. Samurai Champloo y est attendu de pied ferme, avec force matraquage marketing. D’autres productions originales y reçoivent un accueil parfois très enthousiaste, et encourageant pour la suite. Il s’agit de garder l’œil ouvert et faire soigneusement son tri sélectif, pour ne pas être noyé dans des lectures et visionnages cycliques.